Yvette Théraulaz

mars 2004 L'AMOUR D'UN BRAVE TYPE De Howard Barker
Mise en scène Jean-Paul Wenzel
On danse sur les cadavres faute de pouvoir les oublier… La guerre de 14 inaugurait un siècle barbare, les attentats du 11 septembre ont inauguré le suivant
Et nous voici, comme les personnages de « L’Amour d’un Brave Type », tantôt titubant sur les décombres, à fouiller la terre, à commémorer les morts, à graver leurs noms sur une dalle, à les nomme un à un, tantôt dansant sur les cadavres, à se griser d’oubli. (…) Le caractère imprévisible, aveugle, des catastrophes à venir, nous renvoie à l’immédiateté de nos désirs, à leur consommation compulsive, au marché des biens et des plaisirs, des sentiments et du sexe. Tout s’achète et tout se vend, Barker ajoute « tout se met en scène », on prend des poses. Souffrez, baisez, aimez, mourez, vous êtes filmés.
Avec Yvette Théraulaz Actrice Philippe Duquesne Acteur Philippe Houriet Acteur
Auteur du texte Howard Barker / Dramaturge, poète, peintre, metteur en scène. Utilise de nombreuses identités fictives dont : "Houth, Eduardo (1946-....)"
Metteur en scène Jean-Paul Wenzel / Auteur dramatique, metteur en scène et acteur. Co-fondateur avec Claudine Fiévet du Théâtre Quotidien (1975) Directeur artistique de Dorénavant compagnie et, avec Olivier Perrier, du CDN - Centre dramatique national, "Les Fédérés" à Montluçon (1976-2002)
Traductrice Sarah Hirshmuller
Costumes Cissou Winling
Éclairages Isabelle Senègre
Scénographe, décorateur François Mercier
Producteur Dorénavant Cie Compagnie théâtrale
Directeur de salle de spectacle Anne-Laure Liégeois / Metteur en scène. Directrice du Théâtre du Festin, Centre dramatique national de Montluçon, Allier en 2003
L'AMOUR D'UN BRAVE TYPE partie 2
L'AMOUR D'UN BRAVE TYPE partie 1

oct. 2002 JENNY-TOUT-COURT Texte Michel Beretti
Mis en scène Gino Zampieri
Jenny et Yvette, deux grandes dames. La Chaux-de-Fonds «Jenny-tout-court» au TPR, un spectacle remarquable de sensibilité et de qualité théâtrale. Attente fébrile, mardi dernier, à Beau-Site, où le TPR donnait la première de son nouveau spectacle «Jenny-tout-court», sur un texte de Michel Beretti mis en scène par Gino Zampieri. Bon nombre de spectateurs ont connu la vraie Jenny Humbert-Droz, qui a mené son propre combat de femme éprise de justice et partagé l'engagement communiste et socialiste de son mari Jules Humbert-Droz.
Attendue donc au contour, la Jenny de scène, interprétée magistralement par Yvette Théraulaz, a convaincu et séduit. La fragilité apparente du personnage apporte une dimension émouvante. Mais quand il faut défendre des idées, quelle force! La comédienne investit véritablement le personnage, avec une grande sensibilité, glissant sans heurts de l'esprit prime-sautier à la gravité, éludant les questions du visiteur pour mieux y revenir ensuite, donnant sa profondeur personnelle à la vie et aux événements évoqués. «Qu'est-ce que cela vous fait d'avoir raté votre vie?», interroge abruptement son interlocuteur, le comédien Georges Grbic, dans une très bonne composition. Elle semble ne pas entendre, s'affaire, offre du café, ou plutôt du thé, mais elle n'en a plus. «Ah! j'ai encore du chocolat...» Ouvrant la boîte, c'est le visage, les souvenirs de Lu, son mari, qui surgissent. Alors elle rentre dans sa vie et raconte. Par bribes, passant de mots drôles, de souvenirs cocasses ou attachants - joli, quand elle demande Lu en mariage - à la rébellion face au père, aux difficultés de la vie à Moscou, sublimées par la solidarité, jusqu'à la fissure douloureuse.
Un jeune journaliste interroge sans ménagements une femme qui a traversé le 20e siècle. Elle a passé sa vie au service d'un mari qui s'est voué à une cause perdue, le communisme. Elle répond aux provocations du jeune homme, clame sa foi en un monde plus juste, affirme son pacifisme, retrace son itinéraire de femme. Parfois devant ses yeux, les personnages surgis de son passé se confondent avec les traits du jeune journaliste: son père, le pasteur, son fiancé puis son mari, Lu. Elle hésite, se justifie, découvre qu'elle s'est trompée, et le reconnaît. En revenant sur sa vie, elle progresse encore. Jenny-tout-court évoque pour le théâtre une étonnante figure de femme : Jenny Humbert-Droz (1892-2000) avec toutes les facettes de ce personnage : jeune femme amoureuse d’un pasteur non conformiste, elle conquiert leur union de haute lutte ; militante communiste, traductrice à l’Imprekor, elle est en contact, plus que son mari secrétaire général de l’Internationale communiste, avec la population russe ; mère de famille, elle a toujours su recréer un foyer pour son mari et ses enfants, même dans leur chambre de l’Hôtel Lux, même dans las clandestinité ; féministe, elle s’est battue pour que les « ménagères » de Suisse s’éveillent à la politique et soient reconnues comme citoyennes à part entière ; chrétienne, c’est au nom de la justice et des principes évangéliques qu’elle veut changer le monde. Un siècle défile, l’histoire d’une femme se raconte, pour que nous puissions savoir d’où nous venons, pour que s’éclaire le chemin que nous allons prendre. La nuit s’écoule, et le jeune Félix Platter finit par comprendre ce qu’il était venu chercher là.
JENNY TOUT COURT / téléjournal

août 2002 LA CERISAIE d'Anton Tchekov
Mise en scène Jean-Claude Berutti
De la cerisaie, le théâtre de bois accueille le fantôme poétique. C'est une image projetée, autant dire la réalité d'un songe qui fugacement conduit à ce jardin immaculé qui fonde la pièce de Tchekhov ; une forêt de fleurs blanches, frémissant sous quelque léger souffle, fait son apparition sur la scène de Bussang, que hante la figure de Lioubov Andreevna, l'encore propriétaire de ce beau verger condamné. C'est Yvette Théraulaz qui lui donne chair: la comédienne helvète est une impressionnante faiseuse d'art dramatique, ô combien essentielle à cette «Cerisaie». Elle joue Lioubov, la propriétaire de La Cerisaie de Tchekhov dans la mise en scène de Jean-Claude Berutti au Théâtre du Peuple de Bussang
«La Cerisaie» de Jean-Claude Berutti a les traits d'une comédie, presque farce, mais à tout moment bousculée par la petite société humaine funambulique, au bord de la chute, qui la peuple de sa brûlante désespérance. Sous l'assaut des passions familiales, amicales et amoureuses, mais aussi d'un grand désordre matériel, chaque personnage, assez finement caractérisé par un texte qui est ici celui de la traduction d'André Markowicz et Françoise Morvan - leur même version de l'œuvre de Tchekhov avait été montée il y a dix ans par Stéphane Braunschweig, à Orléans, et voici quelques saisons à la Comédie Française - , fait cortège à la tragédie. On ne voit qu'elle sous les grimaces des rires qui costument la longue attente d'avant les adieux. Et c'est elle, encore, qui s'invite sous le masque des allégresses à la dernière fête donnée au domaine, conviant toute la troupe au désespoir, et qui boit et qui danse, au son de l'accordéon, du violoncelle, du violon. Cette scène, à tous égards, est la plus formidablement aboutie de cette «Cerisaie» dans la conjugaison efficace des effets de mise en scène, de scénographie et de jeu, amateurs et professionnels mêlés. C'est un tourbillon trivial et étourdissant, d'aIlées et venues logées dans le mouvement de paravents coulissants imaginés par Rudy Sabounghi fidèle et complice décorateur du travail de Berutti.

mars 2002 BLESSURES AU VISAGE De Howard Barker
Mise en Scène Jean-Paul Wenzel
Avec cette frénésie des têtes chercheuses, Barker fouille la nature humaine, retourne les systèmes, requestionne l'informulable, L'impensable, … Non pas par sadisme ou masochisme Encore moins pour "faire la leçon" La langue de Barker ne souffre d'aucun didactisme. Elle décrasse la pensée, dévérouille les désirs, remet les compteurs à zéro, va fouiller les "gouffres" pour avoir une chance de "trouver la pépite" Peut-être ! Comme disait le poète !
Barker n’est pas tendre avec ses contemporains. Ni avec les autres d’ailleurs. Et sur ses «Blessures au visage » que Jean-Paul Wenzel créé aux Fédérés, il a jeté du vitriol à grands seaux. Pour faire parler les miroirs et ceux qui s’y contemplent, exciter les vanités et les caractères au fil d’une galerie de portraits tracés au scalpel. Quand il parle de «Blessures au visage», Howard Barker ne se fout pas de la gueule du monde. Qui dissèque par le menu les affres en proie auxquelles sont les pauvres humains confrontés à la bête figuration d'eux-mêmes. En dix-huit tableaux, l'auteur, dérangeant, dit-on, Outre-manche, assène quelques-unes de ces bonnes vieilles vérités toujours bonnes à dire quand elles n'ont pas force de loi. Faut dire qu'il est allé les chercher dans les tréfonds de l'âme en dénouant ce qui se joue de plus intime devant les miroirs. Sur la scène des Fédérés, où Jean-Paul Wenzel a créé la pièce, défile une cohorte de personnages trop beaux ou trop moches, faciès vérolé ou figure emblématique, gueule d'amour et visage oublié, menant la ronde infernale des questionnements. Une ronde justement, un cercle vicelard, matérialisé par un plateau dont le bord extérieur tournant amène les comédiens et leurs tourments qui s'en vont et s'en viennent. Et puis, au centre, le cœur de l'arène où la lumière se braque sur ce drôle de cirque qu'est cette apparence de nous même livré en pâture au regard de l'autre. Là où Barker, dans une langue au scalpel, lance le texte sur des montagnes russes qui rythment, sinon les émotions toujours vite refroidies, les sensations. On ne se tape pas sur les cuisses pendant 1 h 50, mais les situations, quelquefois, basculent promptement de la tragédie à la gaudriole. La mise en scène de Wenzel enfonce le clou et le vaste éventail de jeux donné par la dizaine de comédiens, bien à l'aise dans leurs meurtrissures, itou. Dieu est aveugle
Quoi leurs gueules? Qu'est ce qu'elles ont leurs gueules? «Nous sommes un, en dépit des règles et des goûts» envoie une coquette qui n'assume pas sa bobine, «incarcérée dans ce visage contre lequel elle a de sévères objections ». «Votre mâchoire, votre nez, votre bouche... sont partis. Et un œil, aussi» explique, froidement, au mutilé de guerre le chirurgien plastique pour qui «le visage n'est qu'une structure de fibres et de membranes». Une «beauté douloureuse à qui la contemple, les ruines d'une arrogance qui te donne de la dignité» complimente le jeune et bel amant d'une femme vieillissante. Et la future mariée qui se défile devant l'apocalyptique vision produite par la grenade, qui a ripé sur le piquet, qui a pété à la face d'un si beau promis. Et la prisonnière qui a passé 20 ans au trou pour avoir été haï ou aimé et qui espère trouver «sous la croûte de son endurance, la jeunesse d'un visage oublié». Comme si, seule, la vraie vie pouvait marquer les traits. Et le visage invisible d'un pseudo masque de fer dont la voix sensuelle suffit, d'un plaisir annoncé, à faire feuler les dames. En vain, puisque le dissimulé affirme qu'il ne peut faire l'amour sans visage... car on ne peut pas l'imaginer alors qu'il est " déjà. Encore, son excellence à la gueule vérolée "
Avec Felipe Castro, Marysa Commandeur, Anthony Debaeck, David Godet, Gaël Guillet, Alain Mergnat, Corinne Méric, Yvette Théraulaz, Sandrine Tindillière
Scénographie François Mercier / Conception Jean-Jacques Mielczarek / Création lumières Jean-Paul Wenzel et Pascal Ritchie Pérot / Création son Philippe Tivillier / Création costumes Marie-Cécile Winling / Régie générale Jean-Jacques Mielczarek / Régie plateau Jean-Jacques Mielczarek et Frédéric Kunze / Assistantes costumières Élisabeth Dordevic et Christine Thepenier / Plateau Stéphanie Dextre, Véronique Durantin et Séverine Yvernault / Affiches Séverine Yvernault / Décors Jean-Jacques Mielczarek / Construction Jean Jacques Mielczareck, Frédéric Kunze, Nicolas Nore, Richard Tello et Bruce Tisset / Régie Stéphanie Dextre et Pascal Ritchie Pérot / Equipe techniqueDominique Néollier, Thierry Pilleul et Laurent Lureault
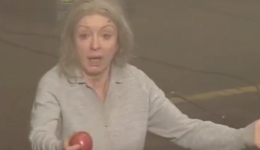
sept. 2001 LA SUPPLICATION De Svetlana Alexiévitch
Mise en Scène Denis Maillefer
Le 26 avril 1986, à 1 h 23, une série d’explosions détruisait le réacteur et le bâtiment de la quatrième tranche de la centrale nucléaire de Tchernobyl, en Ukraine. Trois années durant, une romancière et journaliste biélorusse, Svetlana Alexiévitch, a recueilli les témoignages des survivants. Elle en a tiré un ouvrage, paru en 1996, « La Supplication », ou, en russe, « la Prière de Tchernobyl ».
Lundi soir, 20 heures. Une épaisse fumée envahit cet ancien atelier, immense: plus de cent mètres de long et un plafond, avec verrière, qui semble accroché au ciel. Début du filage, ultime répétition qui précède la générale, un jour avant la première, qui a lieu ce soir. La tension est palpable. Les enjeux artistiques (et financiers, plus d'un demi million de francs de budget) sont à la mesure du lieu. Comment faire vivre ces personnages (ouvrier, épouse, cameraman, liquidateur, jeune fille, fonctionnaire ou vieille femme refusant de quitter la zone sinistrée) dans pareille halle? Comment y garder une part d'intimité? Comment donner densité et cohérence à ce patchwork de chants et de mots? Par terre ou accrochés au plafond, une soixantaine d'écrans TV permettent à la fois de voir le visage des comédiens, filmés en temps réel, et des images déjà enregistrées, en rapport direct ou indirect avec les textes. D'emblée se dégage une atmosphère prenante. La complexité du travail sonore et visuel n'entame en rien le souci de simplicité, de sobriété. Le lieu est suffisamment fort, comme la parole de ces témoins, pour ne pas en rajouter, ni dans le jeu ni dans la mise en scène. Les effets sont pourtant multiples, nécessitant d'ailleurs, lundi soir, deux ou trois pauses, pour les régler. Tâche ardue pour les comédiens: trouver le juste équilibre entre l'incarnation et la seule mise en voix. On reste impressionné par le fait de les entendre aussi bien, chuchotant en solo ou porté par le chœur - 240 petits haut-parleurs sont disposés entre les sièges. Au bout du compte, en moins de deux heures, le temps d'un montage dramaturgique serré, ont pris corps et âme une multitude de vies sacrifiées, dont la souffrance, la colère ou l'amour n'ont eu de cesse d'amplifier. Des morceaux de vie, puisés à Tchernobyl, mais qu'on sait universels. Lundi soir, le temps a filé à toute vitesse, mais pas l'émotion.
Interprétation Monica Budde , Anne-Shlomit-Deonna , Shin Iglesias, Yvette Théraulaz, Jean-Marie Daunas, Bernard Kordylas , Jean-Marc Morel, Gilles Tschudi , Roland Vouilloz
Avec le Choeur de la Supplication Direction : Marc Bochud Musique originale : Velma Mise en scène : Denis Maillefer Dramaturgie : Antoine Jaccoud Scénographie : Massimo Furlan Lumière : Dominique Dardant et Thomas Hempler Son : Philippe de Rham Vidéo : Steven Artels Costumes : Isa Boucharlat Maquillages : Leticia Rochaix Coach mouvement : Leland Patton Stagiaire assistante : Muriel Imbach Direction technique : Daniel Demont Régie : Marc Tuleu , Dominique Dardant, Julien Talpain Administration et communication : Sarah Neumann Assistante de production : Véronique Loeffel Stagiaire administration : Xavière Hammer Intendance : Claire-Do Frund Théâtre de Vevey : Nicole Schneider , François Saint-Cyr , Vincent Olivieri Traduction : Galia Ackerman et Pierre Lorrain Conseillère musicale et langue russe : Inna Petcheniouk Réalisation costumes : Nadia Cuenoud Karine Dubois Assistant son : Bernard Amaudruz Camerawoman : Yaël Ruta Cameraman : Olivier Kunz Cablewoman : Muriel Imbach Poursuites : Enrico Bertinotti, Gilles Cesure , Virginie Favre Auxiliaires techniques : Etienne Müller, Julien Neumann, Jean Monnin, Stéphane Weibel Stagiaire lumière : Thierry Tschudi Photographie de plateau : Mario Del Curto, Aline Paley
Le Choeur de La Supplication Nicole Ayrton, Nicole Barras, Raymond Bataillard, Daniel Brand, Jacques Caspary, Romaine Chappuis, Patrick Charbon, Dominique Chassot, Marie-Paule Chastellain, Simone Chevalley, Michel Cochard, Jean-Rodolphe Dellsperger, Laurence Duport-Comte, Anne-Lise Galley, Marja Gamboni, Jacques Gamboni, Anne-Marie Giarre, Corinne Grosjean, Patricia Jaques, Véronique Jaunin, Muriel Kübler, Danielle Leyvraz, Marie-Caroline Maurer, Grégoire Mayor, Laurence Mermodufour, Charles-Henri Monod, Caroline Neligan, Marianne Pidoux, Mathé Schaeli, Ruth Schlaepfer, Pierrette Schouwey, Jacqueline Seidel, Christian Talon, Myriam Terrin, Claire Vallotton, Anne Vrachliotis, Françoise Wannaz-Rickli, Elisabeth Wirz, Johannes Wirz, Grégoire Yersin, Barbara Zimmermann
Avec le soutien de Etat de Vaud, Loterie Romande, Pro Helvetia, Banque Cantonale Vaudoise, Pour-cent culturel Migros, Fondation Nestlé pour l’Art, Fondation Sophie und Karl Binding, Association du Choeur d’Orphée, Ville de Vevey, Hôtel des Trois Couronnes, CFF, L’Hebdo, TMS – Technique pour la musique et le spectacle
La Supplication
La supplication / Extrait

mai 2000 PERDANTS MAGNIFIQUES
Mise en scène Anne-Marie Delbart
A voir absolument à l'Arsenic: le dernier spectacle du Théâtre Musical. Une centaine de belles et bonnes minutes à savourer. Il est des spectacles qui font du bien, et tel est le premier mérite des «Perdants magnifiques», collage de textes et de chansons enchaînés avec un rare bonheur par une espèce de chorale fellinienne oscillant entre humour et nostalgie, malice et gravité. Les thèmes du spectacle sont gravissimes, puisqu'il s'agit de rien de moins que de la vie et de la mort, du bonheur et de la maladie, du sens de notre présence sur terre et d'un tas d'autres interrogations fondamentales, mais tout cela est traité comme sur des' «pattes de colombe», sans une trace de pontifiance sentencieuse.
A remarquer en premier lieu: que les membres du Théâtre Musical n'ont plus vingt ans, et que c'est donc dans leur chair qu'ils éprouvent tous le poids du monde et la fuite du temps. En outre, ils appartiennent à une génération dont les jeunes années furent baignées de chansons, et l'on en mesure une fois de plus la perte au fil de la représentation. Un premier bonheur nous est donné, précisément par «Le bonheur» de Gilles, qu'Yvette Théraulaz fait merveilleusement revivre au milieu de ses camarades murmurants. Cela étant, plus encore qu'un récital, c'est comme une histoire que nous racontent «Les perdants magnifiques», dont la tonalité mêle la révolte et la générosité, le scepticisme et la joie de vivre, l'insolence et la nostalgie. Sur fond de guerre balkanique et de déprime tous azimuts, il n'y a aucun cynisme, mais un comique tout de même grinçant à l'exécution de «C'est magnifique», cher vieux hit des années dinosaures lancé par la boulotte Marie Perny, aussi à l'aise à l'accordéon qu'au chant ou à la comédie, et dansé par tout le monde à la manière Broadway-Deschamps. Cohabitent en outre, dans ce spectacle au beau titre à la Carver, des bribes de rêves ou de contes (la petite fille de Dubillard qui croise la vieille dame sur le chemin de la vie), avec d'étonnants moments de poésie signés Carson McCullers, Strindberg ou Clarice Lispector), et des morceaux de littérature «existentielle» qui font voisiner Ramuz et Dubillard, Karl Valentin et Albert Cohen, un savoureux inventaire de maladies (la liste semble de fait un programme gastronomique!) et telle irrésistible invective au ciel où l'humour pince sans-rire (Le Clézio) va si bien à Heidi Kipfer. Dans la foulée, et c'est une autre originalité du spectacle, sont dits les faux pas, les hésitations, les couacs, les faiblesses du locataire moyen de la planète Terre (sur laquelle «des milliards d'individus sont morts... et n'en sont pas morts») ou l'incongruité de celle (magnifique Yvette Théraulaz) qui ouvre son cœur en toute sincérité alors que les autres n'en ont rien à «secouer».
Viva la musica La représentation se donne dans une sorte de boîte magique, conçue par Gilles Lambert, et joue sur un minimum de déplacements, parfois à la cadence des figurines de boîtes à musique. Question musique, précisément, c'est un surcroît de bonheur que nous vaut l'apport très «pro» de trois facétieux magiciens (Arthur Besson, Lee Maddeford et Daniel Perrin) et les superbes prestations vocales des trois comédiennes, dont les limites occasionnelles sont largement compensées par l'ardeur et le naturel de l'interprétation. Bref, et sur l'air final du Gracias à la vida de Violetta Parra, l'on ne peut que dire merci aux initiateurs de ces belles variations sur la vie qui va.
Mise en scène Anne-Marie Delbart
Musiques originales et arrangements Arthur Besson, Lee Maddeford, Daniel Perrin
Avec Heidi Kipfer, Marie Perny, Yvette Théraulaz
Musiciens Philippe Ehinger, Lee Maddeford, Daniel Perrin
Décor Giles Lambert
Lumière Patrick Jaquérioz
Peinture Jeff Quesné
Maquillage Catherine Zingg
Coproduction Théâtre Musical – Lausanne, Le Poche – Genève
PERDANTS MAGNIFIQUES

déc. 1999 EMILIE NE SERA PLUS JAMAIS CUEILLIE PAR L'ANEMONE de Michel Garneau
Reprise au théâtre Amstramgram et tournée au Québec
Dix ans après l'avoir créée à Genève, Philippe Morand reprend la pièce de Michel Garneau. Le théâtre est un art d'infidélité. L'acteur épouse un personnage, l'étreint parfois, puis l'abandonne en gambadant, sans demander son reste. Philippe Morand, directeur du, Poche à Genève, brise cette fatalité: Onze ans après avoir guidé Yvette Théraulaz et Véronique Mermoud dans les sous-bois d'Emilie ne sera plus jamais cueillie par l'anémone, il a demandé aux deux mêmes comédiennes de reprendre leur dialogue. Pour un face-à-face doux, lumineux et chamailleur comme le sont les confidences fraternelles au petit matin.
A première vue, elles n'ont pas changé. Dans sa robe solaire, Yvette Théraulaz est toujours Emilie, la poétesse qui a décidé de s'enraciner au milieu de sa forêt, pour vivre plus intensément. Dans sa robe saumon, Véronique Mermoud joue Uranie, la sœur musicienne, sur le point de quitter l'Amérique au bras de son amant. Mais si le théâtre peut donner le sentiment d'un présent permanent, le metteur en scène a voulu marquer le passage du temps. Au-delà du plateau carré, on voit donc une table et des volets posés à terre. Ce sont les vestiges de la première version. Et comme les souvenirs de la maison des morts. Sauf qu'Emilie ne meurt pas vraiment. Elle se détache... intensément. La beauté du spectacle de Morand est de tracer à petites touches cette topographie de la solitude. Ainsi l'opposition quasi physique des comédiennes: à la robustesse presque figée de Véronique Mermoud répond la souplesse fiévreuse d'Yvette Théraulaz. Et la voilà qui s'enivre de mots singuliers, comme une vieille fille se pare de perles rares, pour rêver de valses folles. II y a aussi et surtout ce moment suspendu où, dans une échappée de lumière, Uranie habille Emilie. La poétesse est en blanc à présent, immaculée, comme une mariée bafouée devant l'autel, comme un ange ou une folle. Cette cérémonie des adieux ne s'oublie pas.
Texte Michel Garneau - Emilie Yvette Théraulaz - Uranie Véronique Mermoud- Mise en scène Philippe Morand - Décor et costumes Gilles Lambert - Lumières Liliane Tondellier - Assistanat mise en scène Cléa Redalié - Construction du décor Atelier du Lignon - Peinture du décor Jean-Pierre Arlaud - Réalisation des costumes Nathalie Matriciani - Coiffure et maquillage Johannita Mutter - Régie Jean-Christophe Despond - Technique Dominique Ithurriague - Collaboration littéraire François Marin - Administratrices Maryvonne Joris et Marie-Claude Jenny - Coproduction Théâtre Le Poche et Théâtre des Osses
Véronique Mermoud Nous avions l'habitude de travailler avec les cycles d'orientation et les collèges. Quand Ulysse a été joué à Givisiez, nous avons ouvert une nouvelle porte: celle des écoles primaires. Nous avons vu des élèves qui débarquaient de tous les coins du canton et mettaient parfois pour la première fois les pieds dans un théâtre. Je me souviens de leur excitation à être traités comme des "grands", à s'asseoir sur les fauteuils rouges, à découvrir le rideau de scène. J'entends leurs rires, leurs cris et, quand la lumière s'allume sur le plateau, le silence qui s'installe, la magie qui les touche, leur spontanéité magnifique. Le théâtre en est illuminé.
Gisèle Sallin C'est lié à une coproduction et à un échange. Des relations se créent avec deux théâtres de Genève, Le Poche et Am Stram Gram. Le Poche et les Osses coproduisent Emilie ne sera plus jamais cueillie par l'anémone. Ce spectacle, mis en scène par Philippe Morand, avait déjà été réalisé avec la même équipe artistique et tous souhaitaient refaire une version "en plus grand". Avant d'entamer une importante tournée, la pièce a été créée au théâtre Am Stram Gram. Pendant ce temps le théâtre Am Stram Gram occupait la scène du Poche avec un spectacle pour enfants, Ulysse d'Isabelle Daccord et de Julie Delwarde. Il était interprété par quatre jeunes de Arlequin poli par l'amour qui venaient de terminer leur formation. C'était leur premier emploi et c'était ma première mise en scène pour les enfants : le cadeau de mes 50 ans.
Début de production 18 janvier 2000 au Théâtre Am Stram Gram de Genève et en tournée à Québec, Longueil-Montréal, Sherbrooke puis au Théâtre des Osses et en tournée en 2001 la Chaux-de-Fonds, Avenches, Neuchâtel, Yverdon, Bienne Nombre de représentations 61 (dont 16 scolaires) Nombre d'entrées 8.651 (dont 1.948 en scolaires) Taux d'occupation 76\\\\% Fin de production 31 décembre 2000 au Théâtre des Osses à Givisiez
Emilie ne sera plus jamais cueillie pa l'anémone / Extrait